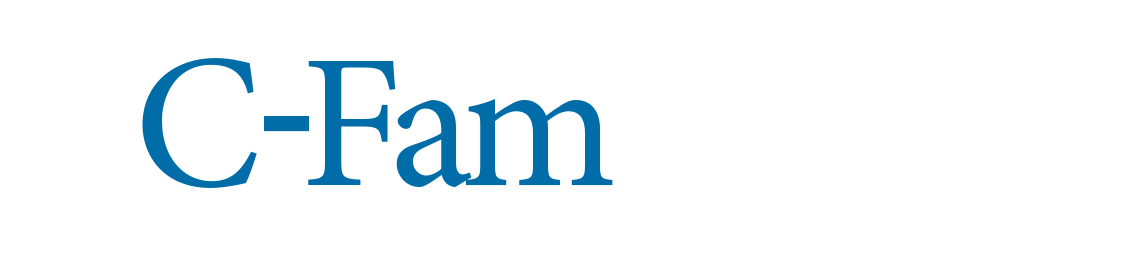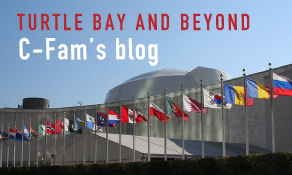Le rapport principal d’ONU Femmes : économie raisonnable ou féminisme radical ?
NEW YORK, 1er Mai (C-Fam). Le récent rapport annuel édité par l’agence de l’ONU pour les femmes met en avant une déconnexion de base entre les états membres de l’ONU et la bureaucratie des Nations Unies.
Le rapport attire l’attention sur la nécessité de filets de sécurité sociaux pour les femmes vulnérables, y compris les veuves, les retraitées et celles qui portent secours aux autres, moyennant rémunération ou non; tous des sujets qui reçoivent un appui majeur dans l’Assemblée Générale.
Mais dans ce rapport une sollicitude se fait également pour les politiques qui ont été rejetées à plusieurs reprises par les états membres de l’ONU, comme le sont “l’éducation complète de la sexualité”, l’avortement, non seulement légalisé mais aussi subventionné par les fonds publics et une définition de l’égalité basée sur des résultats qui cherchent à éliminer les effets des différences entre les sexes à travers des actions intrusives de la part du gouvernement.
L’introduction déclare “le concept central et servant de guide à tout le rapport : l’égalité substantielle pour les femmes ». La notion d’égalité substantielle, qui est ancrée dans le Traité de l’ONU sur les Droits des Femmes (CEDAW), implique que le traitement égalitaire des sexes sous la loi n’est pas suffisant et pour autant les pays doivent avoir une représentation paritaire de femmes et d’hommes dans toutes les sphères, publiques et privées.
Le rapport reconnait l’importance du travail domestique et des soins non rémunérés (envers les malades, les personnes âgées et les enfants) ; et appelle cela « les fondements de toute activité économique ». Brièvement, le rapport réclame la réduction de la charge de ce type de travail à travers des initiatives locales et nationales comme l’accès à l’eau potable, l’électricité et les systèmes d’aides sociales.
Mais il prête beaucoup plus d’attention à l’idée de redistribution des charges de manière égalitaire entre hommes et femmes, aussi bien au sein du foyer que dans les professions « sociales » traditionnelles telles que l’enseignement, les professions infirmières et l’assistance sociale.
Cette redistribution du travail fut un échec y compris dans les pays les plus progressistes et connus pour leur égalitarisme, comme c’est le cas pour la Norvège. « Pousser les hommes à assumer des occupations féminines », en créant des subventions ou des quotas, n’a pas été efficace admet ONU Femmes.
L’égalité substantielle requiert la transformation, non seulement des institutions, mais aussi des “croyances, normes et attitudes qui les configurent, à chaque niveau de la société”. ONU Femmes insiste sur ces changements aussi radicaux bien qu’elle soit incapable de citer un seul pays qui les ait mis en place.
L’idée d’égalité substantielle a été en grande partie promue par les professeures féministes, y compris des membres du comité de CEDAW qui, régulièrement, sermonnent les états afin qu’ils libéralisent leurs lois en matière d’avortement au nom de la garantie d’une égalité pour les femmes.
La théorie appuie le travail des groupes pro avortement comme le Centre pour les Droits de Reproduction, qui défend que « l’égalité substantielle pour les femmes est souvent liée aux droits de reproduction et à l’autonomie des femmes pour décider de leur vie », en insinuant que sans l’avortement les femmes ne seraient pas capables de développer tout leur potentiel.
La structure de l’égalité substantielle ne concorde pas non plus avec les lois des pays comme les Etats-Unis, où en grande partie pour cette raison le Traité CEDAW n’a pas été ratifié. En témoignant devant le Comité Judiciaire du Sénat en 2010, Dr. Susan Yoshihara, de C-Fam, a argumenté contre la ratification du CEDAW parce que « la formulation de l’égalité du genre dans le traité se base sur l’égalité des résultats et non sur l’égalité des opportunités et pour autant est incompatible avec la loi américaine ».
Le rapport fait des observations convaincantes sur les problèmes des femmes à qui on refuse les services sociaux ou la protection légale à cause de leur veuvage, de leur âge avancé, de leur handicap ou pour avoir dédié une grande partie de leur vie à s’occuper de leur famille. Mais il ne propose aucune solution pour recourir à ces besoins qui n’implique pas une intrusion radicale du gouvernement dans les décisions personnelles, en redessinant la nature des sexes, ce qui est à la fois non prouvé et sans précédent, et qui reflète plutôt les points de vue de l’élite des expertes féministes de l’ONU, et non la diversité des communautés humaines dans le monde.
Traduit par Laetitia de la Vega.
View online at: https://c-fam.org/friday_fax/le-rapport-principal-donu-femmes-economie-raisonnable-ou-feminisme-radical/
© 2025 C-Fam (Center for Family & Human Rights).
Permission granted for unlimited use. Credit required.
www.c-fam.org