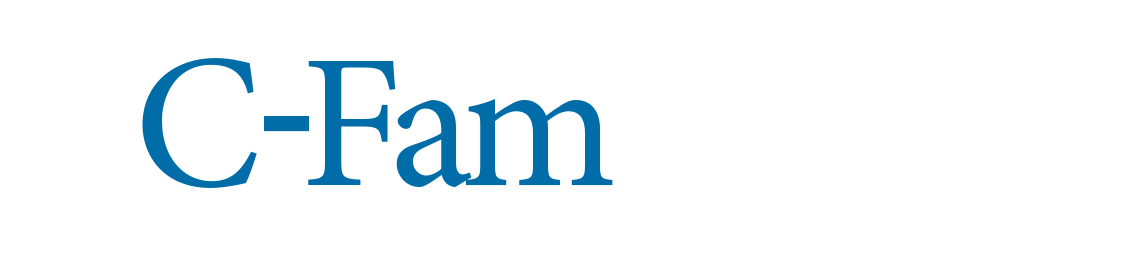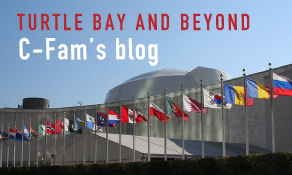Les experts de l’ONU renouvellent la pression sur les pays en ce qui concerne l’avortement et les transsexuels
WASHINGTON D.C., 19 juillet (C-Fam) Depuis le début de l’ année, le comité des droits de la femme de l’ONU a fait pression sur treize pays pour qu’ils libéralisent leurs lois sur l’avortement. Le comité a également exhorté les pays à définir la discrimination à l’égard des femmes en incluant les personnes s’identifiant transgenre et à élargir l’accès aux technologies de procréation assistée.
Le comité a demandé à Singapour de « reconnaître le droit égal de toutes les femmes, y compris celles qui vivent des relations homosexuelles et les femmes non mariées, à la parentalité au moyen des techniques de procréation assistée ». La notion d’un « droit à la parentalité » par tous les moyens nécessaires pourrait être considérée comme impliquant un droit d’accès aux dons d ‘ovules, de sperme, et même à l’utérus de mères porteuses. Cela soulève des inquiétudes quant à la marchandisation des enfants et à l’exploitation des donneurs, hommes et femmes.
Le Comité pour l’Élimination de la Discrimination à l’égard des Femmes (Comité CEDAW) s’est réuni deux fois depuis le début de l’année, examinant huit pays lors de chaque session. Il s’agit d’un organe de suivi du traité qui supervise la conformité avec le traité des Nations Unies sur les droits de l’homme portant sur le même sujet. Le traité CEDAW a été adopté en 1979 par l’Assemblée Générale et ne mentionne ni l’avortement ni l’homosexualité, qui restent des sujets hautement controversés dans les négociations de l’ONU.
À partir de la fin des années 1990, le comité a commencé à ordonner explicitement aux pays ayant ratifié le traité de libéraliser leurs lois sur l’avortement. Depuis lors, la pression n’a fait qu’augmenter. Lors de sa dernière session, le comité a enjoint au Brésil de « légaliser l’avortement, de le dépénaliser dans tous les cas » et de supprimer les obstacles à son accès, y compris l’objection de conscience des prestataires de soins de santé. Le Koweït a été invité à supprimer les exigences relatives à l’approbation par un comité de médecins et au consentement du père. Le Rwanda a reçu l’ordre de recruter et de former davantage de prestataires de services d’avortement et de réduire la stigmatisation sociale qui entoure l’avortement.
Si l’attention portée par le comité sur l’avortement se concentre essentiellement sur la dépénalisation, la légalisation et le renforcement de l’accès, le comité exhorte également les pays à éviter les avortements sélectifs en fonction du sexe et les avortements forcés, de même que l’utilisation de l’avortement comme méthode de planification familiale. Le comité a demandé au Monténégro de « sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à l’impact négatif et à la nature criminelle des avortements sélectifs en fonction du sexe ».
Sur la question du transgendérisme, le Comité CEDAW a demandé à la Malaisie d’interdire explicitement toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et d’inclure ces éléments dans une « définition globale de la discrimination à l’égard des femmes ». L’Estonie a été invitée à fournir « un accès adéquat à un système de soins de santé fondé sur le consentement et l’affirmation du genre, sans discrimination ni stigmatisation » et l’Italie a été exhortée à « promouvoir l’utilisation d’un langage sensible au genre dans les média, y compris en tenant les plateformes des média sociaux pour responsables du contenu généré par les utilisateurs ».
Lors de sa prochaine session, qui aura lieu en octobre, le groupe de travail du comité sur « l’auto-identification de genre et de sexe » présentera un rapport sur les questions relatives à « ce domaine qui évolue rapidement ». Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail a tenu une réunion informelle en ligne avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur les causes et les conséquences de la violence à l’égard des femmes, lequel s’est dit préoccupé par le « risque d’effacement des droits et du langage fondés sur le sexe ».
La rapporteuse, Reem Alsalem, a utilisé ses rapports pour exprimer son inquiétude quant à l’impact du transgendérisme sur les droits des femmes. Alsalem avait précédemment publié une prise de position sur la définition du terme « femme » dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, soutenant que la définition biologique du sexe demeure essentielle pour garantir les droits des femmes et s’appuyant sur les travaux antérieurs du comité CEDAW. Reste à voir quelle position le Comité adoptera dans ses travaux futurs sur cette question hautement contestée.
View online at: https://c-fam.org/friday_fax/les-experts-de-lonu-renouvellent-la-pression-sur-les-pays-en-ce-qui-concerne-lavortement-et-les-transsexuels/
© 2025 C-Fam (Center for Family & Human Rights).
Permission granted for unlimited use. Credit required.
www.c-fam.org