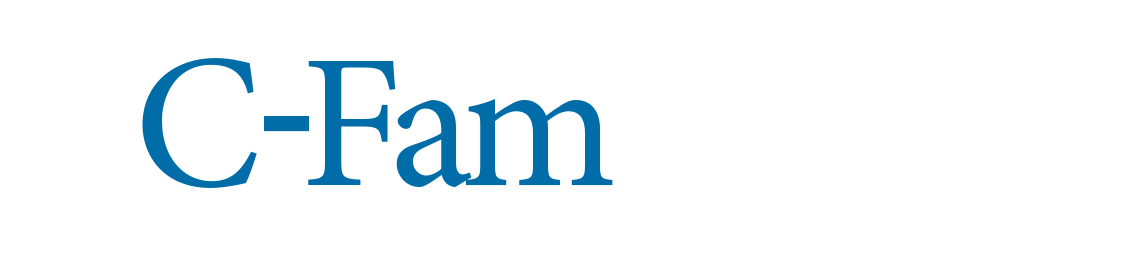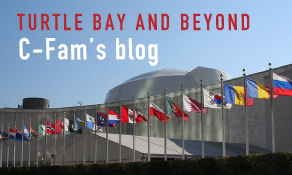Le Bangladesh accusé de contraindre des femmes rohingyas à utiliser des contraceptifs
WASHINGTON, D.C., 6 juin (C-Fam) Il est rapporté que des femmes rohingyas, réfugiées musulmanes ayant fui le génocide au Myanmar, sont contraintes par les autorités bangladaises à utiliser des contraceptifs. Cette contrainte s’exercerait à Cox’s Bazar, une ville portuaire du sud-est du Bangladesh.
Un article de The New Humanitarian détaille des accusations de coercition généralisée dans plusieurs camps. Cinq femmes rohingyas interrogées ont déclaré que des membres du personnel médical et des responsables des camps ont insisté pour qu’elles se fassent poser des dispositifs intra-utérins (DIU). Quatre d’entre elles, qui venaient d’accoucher, ont été informées que leurs nouveau-nés ne pourraient pas être enregistrés si elles n’acceptaient pas le dispositif.
Certains membres du personnel ont tenté de signaler ces pratiques coercitives à leurs supérieurs, mais ceux-ci ont mis du temps à réagir. Le directeur de l’agence humanitaire du gouvernement bangladais chargée de fournir l’aide aux réfugiés n’a pas directement nié les allégations, mais a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une politique officielle de refuser l’enregistrement des naissances ou d’insister pour que les femmes rohingyas utilisent un moyen contraceptif particulier.
Pour les Rohingyas, qui étaient une minorité religieuse dans un Myanmar majoritairement bouddhiste, la coercition reproductive n’est pas nouvelle. Le gouvernement birman leur avait imposé une limite de deux enfants par famille pendant une décennie avant leur fuite vers le Bangladesh pour échapper à la persécution.
Après leur arrivée dans les camps de Cox’s Bazar, des militants internationaux en faveur de l’avortement, tels que l’organisation Ipas, se sont employés à tirer parti de la détresse des Rohingyas pour promouvoir un droit humanitaire à l’avortement. Ils ont noué un partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) pour former des professionnels de santé dans les camps à la pratique des avortements et ont organisé des ateliers pour réduire la stigmatisation liée à l’avortement.
Le rapport de The New Humanitarian ne contient aucune accusation contre les agences onusiennes ou leurs employés ; il cite un travailleur des Nations Unies affirmant que les autorités bangladaises et les médias locaux se sont plaints du nombre trop élevé d’enfants chez les Rohingyas.
Les politiques des Nations Unies insistent sur le fait que la planification familiale devrait être volontaire. Pourtant, la stratégie lancée en 2023 par le gouvernement bangladais en collaboration avec le FNUAP et d’autres partenaires « trace une approche visant à accroître la demande de méthodes contraceptives modernes », en opposition à la satisfaction de la simple demande existante ou de la garantie d’ un meilleur accès à ces méthodes. La stratégie qualifie l’augmentation signalée de l’utilisation des contraceptifs chez les Rohingyas « d’amélioration », tout en notant que les « défis ayant entravé la fourniture en temps voulu de la gamme complète de contraceptifs et de services de régulation menstruelle » sont liés aux croyances religieuses, à la désapprobation des maris et au désir d’avoir des enfants.
La « régulation menstruelle » est un euphémisme pour désigner l’avortement au Bangladesh, où la loi comporte une lacune qui rend légale une procédure d’avortement précoce en l’absence de test de grossesse.
Bien que les défenseurs de la planification familiale, y compris les agences onusiennes, affirment que le recours à la planification familiale doit rester volontaire, ils recourent néanmoins à des indicateurs qui privilégient l’adoption et la poursuite de l’utilisation de méthodes contraceptives, et cherchent à éliminer les « obstacles » à leur utilisation — ce qui pourrait inclure les convictions morales et religieuses des femmes, leurs préoccupations concernant les effets sur la santé, et même leur désir d’avoir des enfants.
La stratégie a particulièrement mis l’accent sur l’introduction des contraceptifs réversibles de longue durée (LARC), tels que les DIU et les implants, dans les camps de réfugiés. The New Humanitarian rapporte que certaines femmes forcées d’accepter des implants ont ressenti de l’inconfort et des malaises par la suite. Pour certaines femmes rohingyas, leur désir d’éviter ces LARC découlait de leur foi musulmane ; d’autres craignaient que, compte tenu de leur statut précaire de réfugiées, elles ne puissent pas plus tard les faire retirer si elles devaient partir pour un autre lieu.
À Cox’s Bazar, la coercition contraceptive n’a peut-être pas été une politique officielle, mais la stratégie employée par le Bangladesh et ses partenaires de l’ONU pour imposer une « demande » a ouvert la voie à une « offre » sous contrainte.
View online at: https://c-fam.org/friday_fax/le-bangladesh-accuse-de-contraindre-des-femmes-rohingyas-a-utiliser-des-contraceptifs/
© 2026 C-Fam (Center for Family & Human Rights).
Permission granted for unlimited use. Credit required.
www.c-fam.org