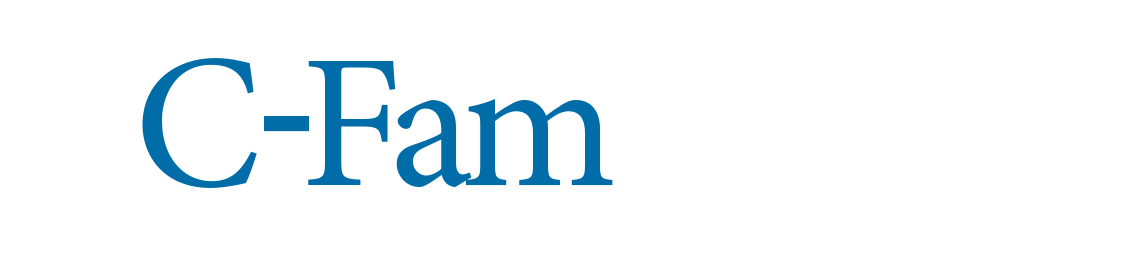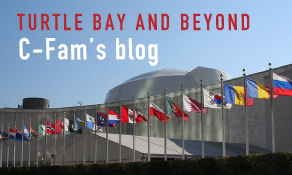Le monde académique considère qu’Obamacare viole le droit international
WASHINGTON DC., 21 mars (C-FAM) L’industrie de la bière veut montrer au grand jour son soutien à la cause homosexuelle pendant les parades de la Saint Patrick. Coca-Cola veut sauver les ours polaires. Pour sa part, Hobby Lobby, une chaine de magasins américaine, veut protéger l’enfant-à-naître.
Si chacune de ces entreprises exerce sa conscience sociale d’entreprise, celle qui se fonde sur ses croyances religieuses est passible d’une amende de plus de 1,3 millions de dollars par jour (presqu’un million d’euros). La loi Obamacare sur l’assurance maladie prévoit une obligation à charge de l’employeur de financer et fournir des contraceptifs, quels que soient les convictions religieuses de l’employeur. Hobby Lobby, une chaine de magasins d’arts manuels dirigés par des chrétiens, refuse de financer l’avortement. Et d’après des professeurs de droit, le droit international donne raison à Hobby Lobby.
La semaine prochaine, la Cour Suprême se penchera sur l’affaire Hobby Lobby, et sur celui de Conestoga Wood Specialties, dont les dirigeants mennonites considèrent qu’il serait « pécheur et immoral » de financer des médicaments qui provoquent des avortements. Ils encourent plus de 95 000 dollars d’amende par jour.
La liberté de religion est « vitale », non pas seulement pour les individus, mais aussi pour les structures à but lucratif ou non lucratif, expliquent des professeurs de droit dans leur mémoire soumis à la Cour Suprême des Etats-Unis au nom de neuf universités et de 27 experts. Le droit international protège la liberté religieuse individuelle et collective, ainsi que sa dimension publique.
Les professeurs s’appuient sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et sur le pacte international sur les droits civils et politiques, ratifiés par les Etats-Unis.
Rien n’oblige les individus à « sacrifier » leur droit humain lorsqu’ils entrent sur le marché du travail, dès lors le gouvernement fédéral ne peut sanctionner les entreprises qui exercent leur liberté religieuse, ont expliqué les experts. Grâce à la liberté religieuse collective, souvent des croyants font usage de leur liberté d’entreprise comme moyen d’expression de leurs croyances.
Les entreprises devraient avoir la liberté de faire exercice de leur conscience institutionnelle au titre de leur leurs croyances religieuses autant que pour des raisons éthiques, telles la responsabilité environnementale, la justice sociale ou d’autres causes. L’opinion du gouvernement Obama, selon lequel les croyances religieuses des dirigeants d’entreprises ne peuvent pas être imputées à leur institution, « n’a aucun sens », affirment les experts. « D’où une entreprise tire-t-elle ses valeurs et ses priorités, si ce n’est de ses propriétaires et de ses dirigeants ? »
Le gouvernement Obama considère que les entreprises ne devraient pas se préoccuper de questions morales et éthiques, mais seulement de profit.
Les juristes donnent des exemples de pays étrangers qui reconnaissent la liberté de religion des entreprises et des organisations sans but lucratif, ainsi que d’organisations internationales et régionales qui reconnaissent la liberté religieuse et de conscience institutionnelle des entreprises.
De plus en plus, la tendance mondiale regarde d’un œil favorable la reconnaissance de la dimension éthique des activités des entreprises, démontre le mémoire. Le UN Global Compact lancé en 1999 par Kofi Annan proclame que les normes de droit international obligent les entreprises à prendre en compte les questions ayant trait aux droits de l’homme. La rédaction de rapports de responsabilité sociale des entreprises est une pratique de plus en plus courante dans le monde des corporations.
Cette tradition de la responsabilité sociale des entreprises a des racines profondes dans l’histoire américaine.
Le mémoire décrit une décision de la Cour Suprême de l’état du New Jersey, qui explique comment les entreprises ont « endossé » des obligations de bonne conduite citoyenne suite au passage des richesses du niveau individuel au niveau de l’entreprise.
Un autre exemple de législation américaine reconnaissant la liberté de conscience des entreprises est leur droit au crédit d’impôt lorsqu’elles financent des associations de charité.
La Cour Suprême entendra les plaidoiries des parties le 25 mars, suite à quoi elle devra décider si la pénalisation des entreprises pour leur refus de se conformer à l’obligation de financer et fournir des contraceptifs constitue une violation des protections fédérales de la liberté de religion.
View online at: https://c-fam.org/friday_fax/le-monde-academique-considere-qu-obamacare-viole-le-droit-international/
© 2025 C-Fam (Center for Family & Human Rights).
Permission granted for unlimited use. Credit required.
www.c-fam.org