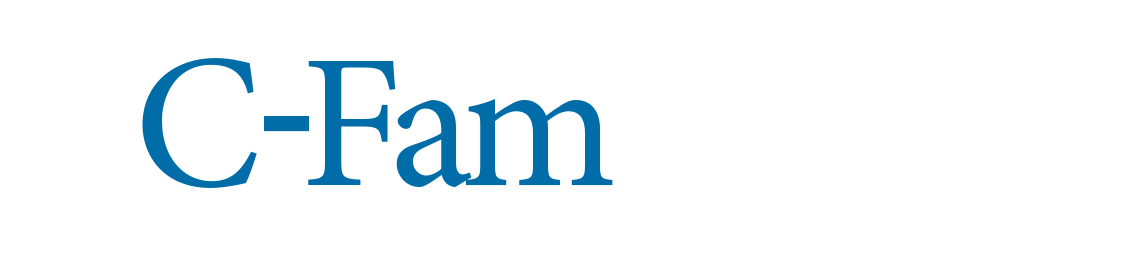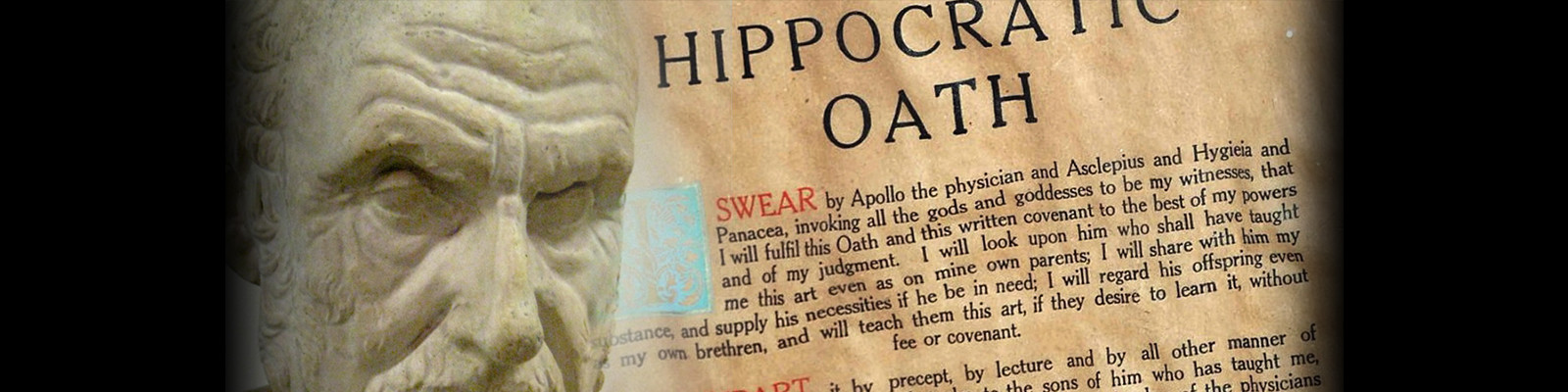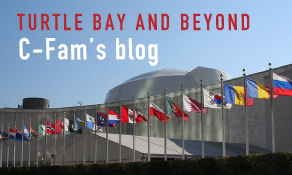Un groupe pro-avortement invite la Cour à priver les pays latino de leur liberté de conscience
WASHINGTON DC, le 26 février (C-Fam). La Cour interaméricaine des droits de l’homme pourrait bientôt arrêter sa décision sur l’obligation pour les médecins sud-américains d’agir contre leur conscience, au moins dans les cas d’avortement.
Dans un document soumis à la Cour, le Centre pour les droits reproductifs (CDR) prétend que les hôpitaux, les organismes de bienfaisance et les facultés n’ont pas le droit à la liberté de conscience en matière de services de « santé reproductive ».
En 2014, le Panama a demandé à la Cour si seules les individus bénéficient de la protection des droits fondamentaux en vertu de la Convention interaméricaine ou si ces mêmes droits s’appliquent aussi bien aux institutions.
Le CDR a affirmé que les institutions ne bénéficient pas de la liberté de conscience ou de religion, mais sont seulement une prérogative des individus. Ils affirment que les institutions – qu’elles soit financées par le secteur privé ou public – ne peuvent jamais refuser d’exécuter ou de participer à des avortements.
De même le personnel médical dans ces institutions ne fait pas exception. En effet, l’obligation pour les États de permettre l’accès légal à l’avortement doit toujours l’emporter, selon le CDR, sur la protection des consciences et des croyances personnelles.
Selon le CDR, le droit international oblige les États à accorder l’accès gratuit aux soins de santé « complets » en matière de reproduction, y compris l’avortement. Le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a récemment déclaré que la « priorité » devrait être accordée dans les crises humanitaires « aux femmes et aux adolescentes à qui il faut fournir des services de santé sexuelle et reproductive, sans discrimination ».
En fait, en droit international, il n’y a absolument aucun consensus à ce sujet parmi les états.
L’accord de 1994 des Nations Unies sur la population et le développement – une résolution non contraignante qui est aujourd’hui la seule base des revendications au nom de santé reproductive – n’a pas reconnu ce droit, mais a stipulé que cette question relève de la compétence des états. De même, le système des droits de l’homme européens n’a jamais reconnu un droit fondamental à l’avortement.
Le droit international n’impose pas aux États de garantir l’avortement, et il n’y a pas non plus d’accord sur ce que la « santé sexuelle et reproductive » comprend réellement. Le Centre pour les droits reproductifs fonde ses arguments sur des recommandations non contraignantes des organes conventionnels des Nations Unies tels que la CEDEF, le traité sur les droits des femmes. Pourtant, aucun traité de l’ONU n’exige que les pays autorisent l’avortement.
La liberté de conscience est un droit universellement reconnu. Elle est protégée par la Déclaration universelle des droits de l’homme, par la Convention européenne et – précisément – par la Convention interaméricaine. Une interprétation restrictive de cette liberté – telle que le CDR le suggère- serait contraire à toutes les chartes, ainsi qu’à bon nombre de Constitutions à travers le monde.
A côté de la liberté de conscience, la Cour interaméricaine envisage de « nouveaux » droits fondamentaux. Deux affaires pendantes se rapportent à l’agenda homosexuel.
Dans une affaire, l’Équateur est poursuivi pour son règlement de discipline militaire qui exclut de l’armée les personnes se livrant à des actes homosexuels. L’autre affaire permettra à la Cour de dire si le refus d’accorder une pension aux conjoints survivants de couples de même sexe constitue une violation des droits fondamentaux par l’État de la Colombie.
La Cour interaméricaine a une juridiction qui s’étend sur plus de vingt États américains du Sud. Ses décisions peuvent façonner et influencer la jurisprudence de l’ensemble du continent américain.
Le CDR est un groupe juridique basé à New York qui plaide pour l’avortement partout dans le monde.
Traduit par Anne-Claire Foltzenlogel
View online at: https://c-fam.org/friday_fax/un-groupe-pro-avortement-invite-la-cour-priver-les-pays-latino-de-leur-liberte-de-conscience/
© 2025 C-Fam (Center for Family & Human Rights).
Permission granted for unlimited use. Credit required.
www.c-fam.org