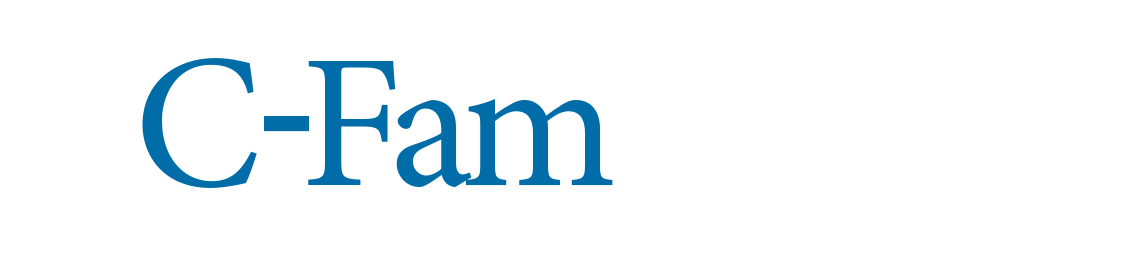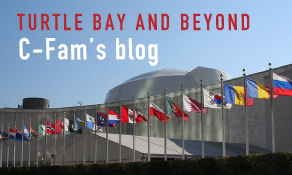Un rapport révèle une profonde fracture entre les agences de l’ONU et les États membres en matière de genre
WASHINGTON, D.C. 28 février (C-Fam) Alors que l’ONU se prépare à commémorer le 30e anniversaire de la conférence historique de Pékin sur les femmes, un nouveau rapport du Secrétaire général soulève une question clé : les États membres sont-ils invités à réaffirmer ce qu’ils ont accepté en 1995 ou s’agit-il d’un programme totalement déconnecté et controversé promu par les agences de l’ONU ?
Le rapport du Secrétaire général vise à évaluer l’état de mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Pèkin. Cependant, une grande partie de ce qu’il évalue ne faisait pas partie de cet accord initial – en fait, une grande partie a été volontairement exclue en raison du manque de consensus et de la forte opposition des gouvernements plus conservateurs.
La question de l’avortement a été soulevée à la fois à Pékin et à la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), qui s’est tenue l’année précédente. Dans les deux négociations, et dans les négociations de l’ONU depuis lors, les tentatives d’introduire un droit humain international à l’avortement ont été rejetées. Dans le rapport du Secrétaire général, une section sur « l’accès des femmes à des services de santé abordables et de bonne qualité » comprend un paragraphe sur les pays qui ont libéralisé leurs lois sur l’avortement. Une section sur « la protection des droits humains des femmes dans les conflits et les crises » mentionne « les soins d’avortement en temps opportun » comme un service pour les femmes qui ont survécu à des violences sexuelles liées aux conflits, ce qui implique qu’il s’agit d’un droit international.
Les universitaires ont commencé à tirer la sonnette d’alarme sur l’idéologie du genre lors de la conférence de Pékin et de la CIPD. Dans l’accord de Pékin, le terme « genre » a été soigneusement qualifié : il ne devait être compris que selon son « usage ordinaire, généralement accepté ».
Les agences de l’ONU, y compris celles spécifiquement chargées de mettre en œuvre la plate-forme de Pékin, ne se sont pas limitées à cette définition. Le rapport du Secrétaire général, qui fait référence au « genre » près de huit cents fois, évoque les personnes transgenres ainsi que les « femmes, les filles et les personnes de genres divers », ainsi que l’acronyme « LGBTQ+ ».
L’expression « santé et droits sexuels et reproductifs » (SDSR) a été rejetée à plusieurs reprises par l’Assemblée générale et d’autres organes de négociation de l’ONU depuis les années 1990, mais elle est couramment utilisée par les agences de l’ONU. Elle n’a été définie que par des organisations non gouvernementales, qui insistent sur le fait qu’elle inclut l’avortement, l’idéologie du genre et d’autres questions controversées comme l’éducation sexuelle complète. La SDSR apparaît également dans le rapport du Secrétaire général, qui appelle les pays à « et à maintenir une attention particulière à l’accès à la SDSR et à sa qualité ».
Le rapport se positionne également en opposition à la « résistance croissante » des gouvernements conservateurs et des organisations de la société civile aux excès de l’ONU. Il cite l’« Appel de Clarion » du Secrétariat de l’ONU en faveur de l’égalité des sexes, qui exhorte les dirigeants de l’ONU à « insister systématiquement pour que les droits des femmes et des filles, l’égalité des sexes et la SDSR soient abordés dans tous les rapports et briefings du Secrétaire général ». L’« Appel de Clarion » est présenté comme une réponse aux campagnes d’« idéologie anti-genre » et à un « programme anti-droits plus large », termes utilisés pour exclure les voix conservatrices traditionnelles de la participation au système des Nations Unies.
Le rapport du Secrétaire général contient plusieurs mentions de « désinformation » et de mésinformation comme menace aux droits des femmes, sans préciser d’exemples. Comme pour le langage « anti-droits », ce cadrage a été utilisé pour justifier la censure des voix dissidentes dans les débats à l’ONU et ailleurs.
View online at: https://c-fam.org/friday_fax/un-rapport-revele-une-profonde-fracture-entre-les-agences-de-lonu-et-les-etats-membres-en-matiere-de-genre/
© 2026 C-Fam (Center for Family & Human Rights).
Permission granted for unlimited use. Credit required.
www.c-fam.org