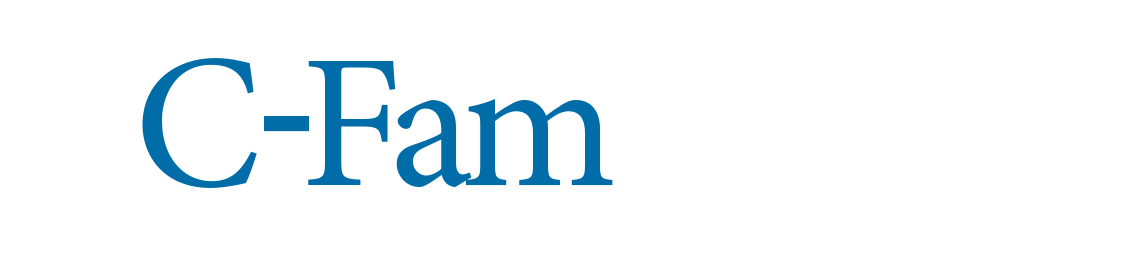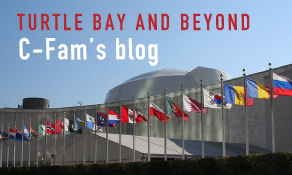ANALYSE : La baisse du nombre de morts maternelles n’équivaut pas à une amélioration de la santé maternelle
NEW YORK, 25 mai (C-FAM) Dans le monde, le nombre de femmes qui meurent en couche a diminué de moitié par rapport à il y a vingt ans, affirme un rapport de l’ONU. Cette bonne nouvelle dissimule le fait malheureux que les nombreuses femmes qui voudraient plus d’enfants dans de nombreux pays continueront à risquer leur vie pour les avoir.
Au niveau international, on dit que le nombre de morts maternelles diminue parce que le nombre de naissances diminue. Au niveau individuel, une baisse du nombre de grossesses peut faire diminuer les risques de mort en couche. Mais lorsque les mères choisissent d’avoir des familles nombreuses, elles courent un plus grand risque, et même des risques extrêmement graves, affirme ce nouveau rapport. Les risques de mourir que courent les femmes ne disposant que d’un revenu modeste s’élèvent à 1 sur 56, et ce pour des causes en lien avec leur grossesse. Dans les pays riches, les risques de mort sont de 1 sur 42000. En Afrique subsaharienne, le risque est très élevé : de 1 sur 39 ; il est 4,5 fois plus élevé que la moyenne mondiale.
Pendant des années, les agences d’aide les plus importante du monde ont fait du planning familial leur priorité numéro un, comme solution pour faire baisser le nombre de morts maternelles, et dans la foulée pour faire baisser encore le taux de natalité. Les besoins liés aux interventions médicales faites pour traiter réellement la santé maternelle – grâce à un personnel qualifié dans les soins liés à la naissance et aux soins prénataux – ont été rabaissées au deuxième ou troisième échelon de priorité sur la liste des financements.
Une raison pour cela est que les agences estiment qu’il est plus facile de distribuer des contraceptifs que de remettre en état des systèmes de santé dans des pays lointains. Une autre explication est que la « prédominance des contraceptifs » est plus facile à mesurer que les améliorations qualitatives que permettent les soins médicaux. Dans une période de contraintes fiscales et d’exigences de responsabilité exigées par les donateurs, les intérêts particuliers des agences donnent les poussent à mettre la priorité sur des mesures qui ne sont pas cohérente médicalement.
Prenons par exemple le commentaire de nouveaux chiffres par le directeur exécutif de l’UNFPA, Babatunde Osotimehin. Utilisant les mêmes mots que son prédécesseur dans les rapports passés, M. Osotimehin pousse à encore plus de planning familial en déclarant : « Nous savons quoi faire, nous savons comment le faire. Nous allons simplement intensifier les même mesures ».
Influencent aussi l’agenda de la santé maternelle les objectifs clairs fixés au niveau international, et qui ne reflètent pas nécessairement les réalité locales. Lors du passage au 21ème siècle, les élites dirigeantes internationales s’étaient accordées sur le besoin de réduire radicalement le taux de mortalité maternelle dans leurs pays et dans le monde entier à hauteur de 75% d’ici 2015.
Chaque Etat qui a pu attendre ce but a aussi fait l’expérience d’une baisse radicale du taux de natalité, en témoignent les estimations de l’ONU. Parmi ces dix pays, tous les pays en voie de développement sauf un ont vu leur taux se réduire de manière dramatique. Les autres pays ayant atteint ce but sont des pays européens, qui avaient des taux de natalité déjà inférieurs à 2 enfants par femme, et qui ont continué à diminuer.
Contrairement à la situation dans ces pays, un tiers des femmes décédées en couche en 2010 venait d’Inde ou du Nigéria, où la pauvreté règne en maîtresse, alors que les familles sont généralement nombreuses. En tout et pour tout, une femme court des risques élevés de mourir en mettant un enfant au monde dans 40 des 18 0 pays évalués. C’est au Chad ou en Somalie, où les femmes avaient en moyenne plus de 6 enfants entre 1990 et 2010, que les femmes courent le risque le plus élevé au monde pour leur vie. Ces pays dévorés par la guerre, sont les seuls dans lesquels les taux de mortalité maternelle sont qualifiés d’ « extrêmes ».
Et même si le rapport assure « Toutes les régions concernées par les OMD ont bénéficié d’une baisse du taux de mortalité maternelle », il n’existe aucun signe que les efforts internationaux qui mettent la priorité sur le planning familial, ait changé les choses pour les femmes pauvres, ou les femmes qui choisissent d’avoir une famille nombreuse.
De fait, le taux de mortalité maternelle pourrait être bien plus élevé que le pensent les experts. Le taux de mortalité est élevé dans les régions ou les données sont les plus rares. Le rapport admet que les données de qualité n’existent que dans les régions où ont lieu seulement 15% des naissances, particulièrement dans le monde en voie de développement. Dans 27 des 180 Etats objets de l’enquête, il n’existe aucune donnée. Dans 88 Etats, les données de qualité manquent. En fin de compte, malgré l’amélioration des techniques pour rassembler et analyser les données, personne ne sait réellement combien difficile est la situation concrète de la plupart des mères. Le rapport conclut que « il n’est pas possible d’expliquer complètement pourquoi certains pays ont vu leur taux [de mortalité maternelle] décliner plus que d’autres, et pourquoi certains n’ont fait aucun progrès ».
A la différence des priorités onusiennes, qui consistent à faire diminuer le taux de natalité grâce au planning familial, les ministres de la santé réunis à Washington le mois derniers se sont exprimés en faveur d’une meilleure santé maternelle et de meilleurs systèmes de santés pour les accouchements. Le ministre de la santé de République Dominicaine, Dr. Bautista Rojas, déclarait que « les éléments clés » du programme de santé de son pays qui ont permis d’améliorer la qualité des soins sont « le soin obstétrique d’urgence… une série de pratiques de soin maternel destinés à sauver des vies, et un système de formation professionnel et de vérification par liste de contrôle ».
Le cambodgien Dr Mam Bunheng a attribué le succès à la fin de la guerre, à la croissance économique, à l’amélioration des structures routières, à l’augmentation et à la modernisation des soins de santé, et à la formation de sages-femmes. Son pays a mis en place une politique incitative pour les sages-femmes, en versant 15$ aux centres de santé et 10$ aux hôpitaux pour chaque naissance bien déroulée dans leur centre. Allant à revers de la politique des agences d’aides internationales, le ministre de la santé Cambodgien a mis le planning familial en avant dernière position sur la liste des six défis auxquels son pays fait face, mettant au premier rang la survie des nouveau-nés, l’accès aux hôpitaux et l’amélioration de la qualité des soins au premier rang.
La motivation idéologique, qui pousse à voir dans la réduction du nombre de grossesses la solution au problème des morts maternelles, reste inchangée par rapport aux anciens rapports de l’ONU. Ceux-ci affirment toujours que plus de 500 000 femmes meurent en couche chaque année. L’ONU a été forcée de réviser ce nombre en le réduisant quasi de moitié depuis qu’un groupe de chercheurs indépendants de l’université de Washington a remis en question les données de l’Onu ainsi que sa méthodologie, en 2010. A cette époque, certains chercheurs ont affirmé que leurs collègues de l’ONU s’étaient compromis à cause des objectifs de politique publique. C’est la deuxième édition consécutive du rapport de l’ONU, comparant sa méthodologie avec celle des chercheurs indépendants, qui concède de fait que l’ONU n’est plus le standard par excellence en matière de santé maternelle.
View online at: https://c-fam.org/friday_fax/analyse-la-baisse-du-nombre-de-morts-maternelles-n-equivaut-pas-a-une-amelioration-de-la-sante-3738/
© 2025 C-Fam (Center for Family & Human Rights).
Permission granted for unlimited use. Credit required.
www.c-fam.org